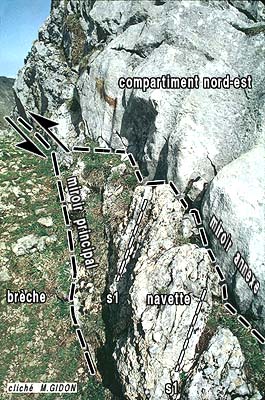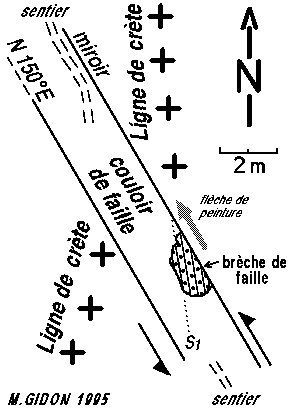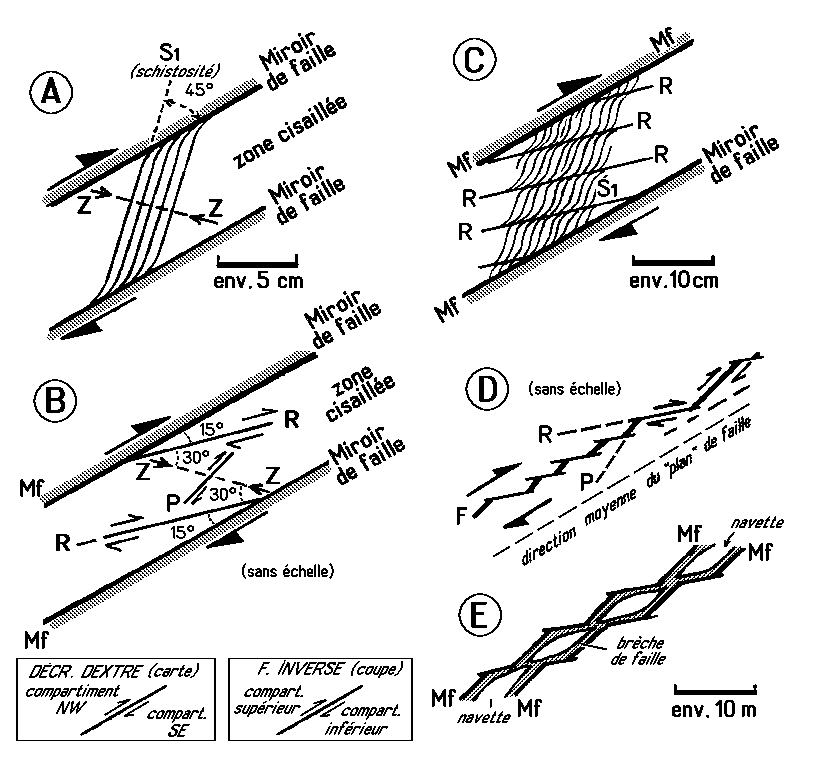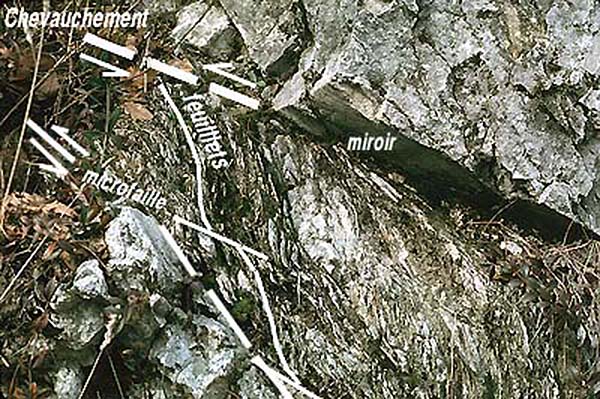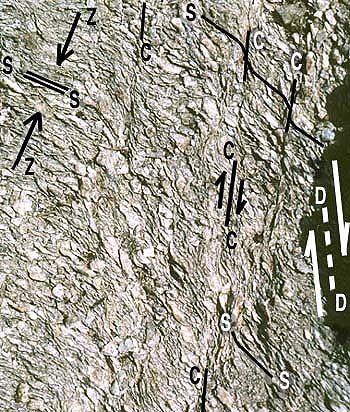| Microstructures des couloirs de
faille
|
Le plus souvent une faille n'est pas une surface plane, sans
épaisseur, mais se révèle jalonnée
par un coussinet de roche plus ou moins épais, qui constitue
un "couloir de faille", entre les lèvres de chacun
des deux compartiments en mouvement relatif. Sa largeur varie,
d'une faille à l'autre et d'un point à l'autre d'une
même faille, depuis un décimètre jusqu'à
quelques mètres pour les failles importantes.
Cette tranche de roche intercalaire est "broyée"
plus ou moins intensément car il s'exerce, entre les deux
compartiments en déplacement, un serrage qui induit une
friction analogue à celle qui a lieu dans une meule (c'est-à-dire associant du cisaillement et de l'écrasement).
Il en résulte la formation d'une brèche
de faille ou d'une mylonite,
suivant la nature de la roche et l'intensité des pressions.
Le couloir de faille du passage des Roches Rousses (sentier entre
le col de Léchaud et le col de Bovinant)
 1/ vu
du sud ...
1/ vu
du sud ... .. 2/ vu d'enfilade du sud-est ...
.. 2/ vu d'enfilade du sud-est ...
 3/ schéma
cartographique
Le sac à dos est posé
sur la lèvre sud-ouest du couloir de faille. La flèche
rouge est tracée sur sur le calcaire massif urgonien de
la lèvre opposée (lèvre NE).
3/ schéma
cartographique
Le sac à dos est posé
sur la lèvre sud-ouest du couloir de faille. La flèche
rouge est tracée sur sur le calcaire massif urgonien de
la lèvre opposée (lèvre NE).
La zone de brèche du couloir de faille, large de 2 m et
de teinte plus jaunâtre, est déprimée et utilisée
par le sentier. Elle est bordée par un miroir de faille
(visible à l'extrémité gauche du cliché).
Dans le quart inférieur droit de la photo un morceau de
brèche de faille plus compacte, correspondant à
une navette* intercalaire, affleure en saillie devant le miroir
et le cache : on y voit une ébauche de feuilletage mylonitique
(encore espacé et grossier), noté S1 sur
le schéma, dont l'angle aigu par rapport au miroir de faille
pointe vers la gauche (vers le nord-ouest).
La verticalité du miroir atteste qu'il s'agit d'un décrochement
et la disposition du feuilletage de la brèche tectonique
montre que son jeu était sénestre (comme c'est le
cas général pour les cassures NW-SE) : le sens de
la flèche correspond donc au mouvement relatif de la lèvre
qui la porte (voir à ce sujet le schéma A ci-après).
 |
Couloir de faille rempli
d'une brèche ayant subi un début de mylonitisation
Sentier du couloir ouest du Petit
Som, 20 m sous le débouché sur la crête
(pour plus de précisions voir le fascicule
1Q)
Le cliché a été pris presque verticalement
(et donne donc une vue quasi cartographique). Le trait S donne
l'orientation du feuilletage mylonitique fruste qui apparaît
ici dans la brèche de faille (noter la verticalité
du miroir qui indique que l'on a affaire à un décrochement).
Les demi flèches indiquent le sens relatif (sénestre)
du déplacement des lèvres de ce décrochement,
tel que l'on peut le déduire de l'orientation du feuilletage.
image sensible au survol et au clic
|
Le résultat peut se limiter à ce broyage. Dans
d'assez nombreux cas il se développe au contraire des microstructures
organisées, dont l'agencement géométrique
est d'ailleurs étroitement lié au sens du mouvement.
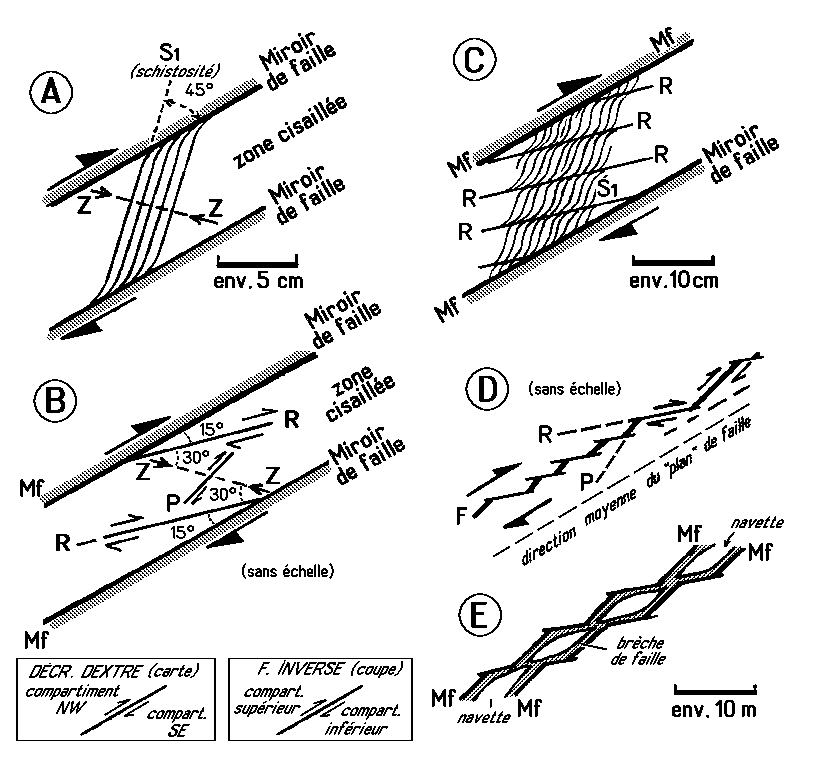
Schémas montrant les relations géométriques
existant entre les failles et les structures microtectoniques
associées
On s'est limité aux cas fréquemment
observés en Chartreuse.
Le mouvement relatif des deux compartiments est indiqué
par les demi-flèches grasses.
Les schémas A, B et C donnent un représentation schématique de la disposition
géométrique des plans de déformation microtectonique
dans le couloir de faille, entre les deux miroirs de faille (Mf),
c'est-à-dire dans la "zone cisaillée",
où se concentre la déformation et leur disposition
par rapport à la direction principale de raccourcissement
(Z).
Le schéma B montre notamment la disposition angulaire
des failles secondaires, "de Riedel", ainsi créées
et le schéma C montre comment elles sont disposées en échelons.
Leur intersection avec le feuilletage schisteux aboutit à
une texture de déformation microtectonique de la roche
dite texture S/C, où les plans de schistosité
(S s'entrecroisent avec des plans de cisaillement (C)
que sont les microfailles P.
Le schéma D montre le
rôle que jouent souvent les fractures secondaires pour donner
au tracé des failles principales un dessin en baïonnette
(notamment à l'échelle décamétrique).
Le schémas E montre enfin comment ce tracé
en zig-zag peut détacher des "navettes" entre
les deux miroirs de faille majeurs (Mf).
N.B. : comme le résument les
deux schémas encadrés en bas à gauche, la
figure représente aussi bien les géométries
observables en vue verticale (cartographique), dans le cas d'un
décrochement dextre (sens de mouvement de loin le plus
représenté en Chartreuse) que celles visibles en
coupe, dans le cas d'une faille "inverse" (c'est à
dire de chevauchement). Dans ce dernier cas, pour se placer dans
l'orientation la plus fréquemment rencontrée en
Chartreuse, il faut considérer que l'ouest serait à
droite (donc que l'on observe la coupe depuis le coté nord).
On trouvera des commentaires
plus détaillés ci-après, dans le texte de
la page.
Dans les couloirs de faille le mouvement relatif des deux compartiments
(demi-flèches grasses) est oblique aux efforts de raccourcissement
qui sont à l'origine de la faille (lesquels s'exercent
en fait sensiblement selon l'horizontale de la figure). Il en
résulte, au sein du couloir de faille, une tendance à
l'écrasement, selon Z (direction de raccourcissement interne
au couloir)
Ceci induit une déformation microtectonique qui peut
s'y exprimer par l'apparition de deux sortes de surfaces, les
deux se trouvant fréquemment combinés (fig. C) :
- des feuillets d'aplatissement dans les roches relativement plastiques
(argileuses) : la roche devient une mylonite
(schéma A) ;
- des fractures secondaires, ou microfailles (schéma
B) , dans les roches plus rigides (calcaires).
La disposition géométrique de ces surfaces est
étroitement liée au sens du mouvement et permet
donc de déterminer celui-ci en cas d'absence d'autres indices
:
- disposition du feuilletage schisteux dans une mylonite (schéma A) : les feuillets
S1 (assimilables à de la schistosité) se disposent
orthogonalement à la direction de raccourcissement Z et
dessinent un "crochon" sigmoïde aux approches du miroir de faille le plus proche.
image sensible au survol et au clic
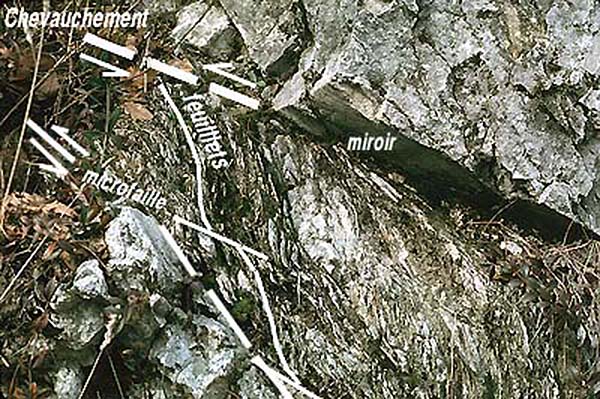
|
Le miroir de la faille
de chevauchement de la Bastille, en contrebas des remparts,
le long du chemin montant par l'église Saint-Laurent.
Ici le miroir de faille surplombe localement une poche de mylonite,
qui représente en quelque sorte une navette écrasée.
Noter la torsion "sigmoïde"
(en S) des feuillets ("crochons", dans le sens du mouvement)
aux approches des surfaces de cassure. Elle est mieux visible
sur un cliché pris de plus
près.
|
- disposition des microfailles (schéma
B) :
Les fractures les plus importantes sont celles, dites "de
Riedel" (R). Elles se disposent à environ 30°
de la direction de raccourcissement Z et se branchent à
angle aigu (environ 15°) sur le miroir, "dans le sens
voulu pour que le mouvement de la faille principale puisse s'y
engager" (en fait il peut théoriquement s'en former
une deuxième famille "conjuguée" mais
on n'a représenté que les failles de la famille
qui se développe de loin le plus fréquemment).
Dans certaines conditions il apparaît aussi des failles
"P" qui se disposent de façon à peu prés
symétrique aux "R", par rapport à la direction
du couloir et finissent par les connecter.
- combinaison des deux types de déformation, aboutissant
à la structure dite "S/C" (schéma
C). C'est l'aspect le plus commun des zones de mylonites :
les microfailles R tordent en "crochons" sigmoïdes
les feuillets S1 qu'elles sectionnent.
Des exemples en sont fournis par la mylonite de la faille de chevauchement de la Saucisse, dans
les pentes de la Bastille, par le couloir de faille du décrochement
du col de l'Alpe, à Valfroide,
et par celui du chevauchement de la Chartreuse orientale, au tournant
1442 de la route
pastorale du Charmant Som.
 |
Mylonite à structure S/C typique
Cliché pris le long du chemin
montant à la Bastille
depuis le square
Cularo, en contrebas des remparts : la surface représentée
est à peu près verticale et mesure environ 50 cm
de coté.
image sensible au survol et au clic
|
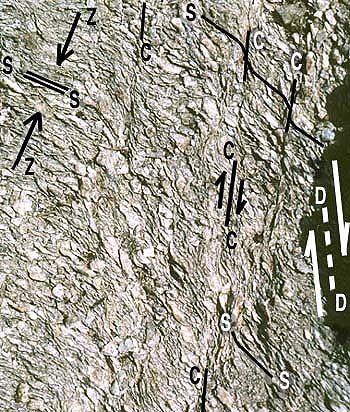 |
Structure
fine du Sénonien dans le couloir de cisaillement bordant
le décrochement du col de l'Alpe
Cliché pris le long du sentier,
en aval des ruines
de Valfroide : la surface représentée est presque
horizontale (photographiée en vue plongeante) et mesure
environ 50 cm de coté.
C'est un autre bel exemple de "texture
S/C" :
Z indique la direction du raccourcissement responsable de l'écrasement
qui crée le feuilletage S.
D indique la direction et le sens de coulissement de la faille
principale (située en réalité quelques mètres
plus à droite que les limites du cliché).
C désigne les microfailles crées par le cisaillement
dû au mouvement le long de la faille.
|
- combinaison de failles de deux types, aboutissant à
un tracé de faille "en baïonnette"
(schéma D) : à
toutes échelles, et notamment à l'échelle
décamétrique, le tracé de détail des
cassures est souvent formé de tronçons représentant
alternativement des failles R et P inter-connectées.
- formation de "navettes" (schéma
E) : ceci est une variante du schéma D, dans laquelle
des fragments losangiques ont été découpés
par l'intersection de couples de failles P et R. Les panneaux
rocheux amygdalaires ainsi isolés ("navettes")
s'effilent à leurs extrémités et sont souvent
séparés par des couloirs secondaires de brèche
de faille. Ils subissent un déplacement de valeur moindre
que celui des compartiments entre lesquels ils s'intercalent.
image sensible au survol et au clic
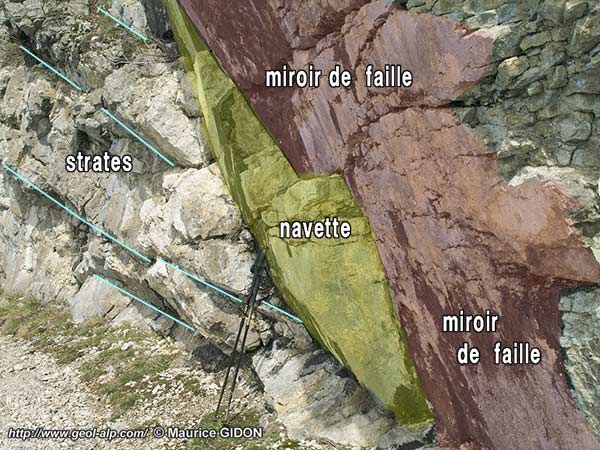
|
Strates (vues d'enfilade) tranchées par une faille mineure
avec navette en section transversale
et miroir de faiile à la face inférieure de la lèvre de droite ("supérieure")
Tithonique inférieur du Saint-Eynard, au pied des escarpements terminaux. |
D'autres exemples sont fournis, en Chartreuse, par la cheminée
ouest du Petit Som, par le décrochement de l'Oeuillette (le long de l'ancienne route des Chartreux) et par le monolithe
de l'Oeille à la Dent de Crolles (ci-dessous), etc ...
|
Le Pas de l'Oeille, vu depuis
Chamechaude (à une distance et une altitude éliminant les déformations perspectives).
f.O = faille de l'Oeille : la faille se partage au niveau du monolithe de l'Oeille en deux cassures secondaires qui le limitent : celle de droite est partiellemnt masquée par le monolite dressé mais toutes deux se rejoignent en haut comme en bas : ce monolithe est une "navette" ;
f.s = faille satellite.
Le compartiment oriental ("supérieur") de la faille est abaissé
d'environ 20 m ; la valeur du rejet se déduit de
ce que la portion de montagne visible a une dénivelée
d'environ 200 m (voir le repère d'altitude en bas gauche du cliché).
Le sentier de la voie normale de montée depuis le col des
Ayes est figuré en jaune.
|
image sensible au survol et au clic
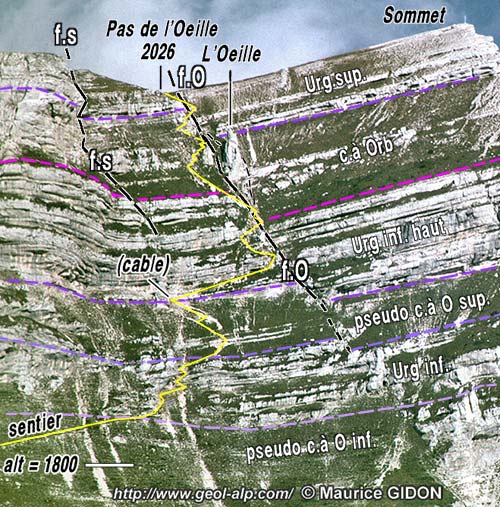
|
Il est à noter également que les connections entre branches de
failles élémentaires, que ce soit à l'échelle
décamétrique, hectométrique ou même kilométrique,
répondent souvent au schéma de
Riedel (schémas D et E)
: un très bel exemple en est donné par le décrochement
de l'Alpette dans le secteur de Saint-Pierre-d'Entremont.
 voir aussi : microstructures
des lèvres de faille
RETOUR AU
DÉBUT DE LA PAGE D'ACCUEIL
voir aussi : microstructures
des lèvres de faille
RETOUR AU
DÉBUT DE LA PAGE D'ACCUEIL