Lac des Béraudes |
Le lac des Béraudes se situe en rive droite de la Clarée, au cœur des crêtes rocheuses calcaires du massif des Cerces, peu au sud du sommet de ce nom. Les pentes qui permettent d'y accéder par son versant oriental (celui de la Clarée) traversent d'abord le flanc occidental du grand anticlinal ses Gardioles, où l'érosion a mis à nu les couches paléozoïques (c'est d'ailleurs un exemple frappant d'"inversion du relief").
Dans le détail ce matériel se révèle affecté par une complication assez importante, l'accident des Drayères, dont le tracé (venant du nord) aboutit ici en butant contre la limite inférieure des terrains mésozoïques. Il y présente en outre une géométrie assez éloignée de celle d'une cassure sub-verticale qu'on lui connaît plus au nord, ce que l'on peut sans doute interpréter comme le résultat de la déformation alpine d'une ancienne structure hercynienne. |
C'est un lac de verrou dont la cuvette a été affouillée par un glacier local, fondu de longue date. Elle est creusée dans les marbres en plaquettes (calcschistes planctoniques néocrétacés) du coeur du synclinal des Cerces. Son verrou est, quant à lui, armé par une barre presque verticale de calcaires et de dolomies triasiques qui affleurent en contrebas est, versant Clarée.
Mais au niveau du lac, notamment sur la rive
septentrionale où les affleurements sont le plus accessibles,
on constate l'absence, entre ces deux formations, de tous les
termes jurassiques intermédiaires habituels. Ils y sont
remplacés par de puissantes brèches à éléments
calcaréo-dolomitiques, qui forment, en rive sud, le piton
de la Pointe des Béraudes.
Au sein de ces brèches on peut en outre distinguer des
brèches inférieures, massives et à ciment
très peu abondant, et des brèches supérieures,
en crachées discontinues qui sont interstratifiées
dans les premiers lits de calcschistes (le plus souvent rouges)
de la base des marbres en plaquettes.
Ces brèches proviennent nécessairement de l'érosion par éboulement d'un escarpement existant aux environs au Crétacé supérieur (date de leur dépôt et de leur cimentation).
Or le coeur du synclinal des Cerces est affecté par la faille du Lac Rouge, dont la lèvre occidentale est fortement surélevée. De plus sur cette lèvre les calcschistes planctoniques néocrétacés reposent sur des couches plus anciennes que d'ordinaire. En effet celles-ci sont soit des calcaires triasiques inférieurs (butte 2709) soit des quartzites werféniens (col du Lac Rouge), ce qui témoigne d'une érosion anté-Néocrétacé particulièrement intense.
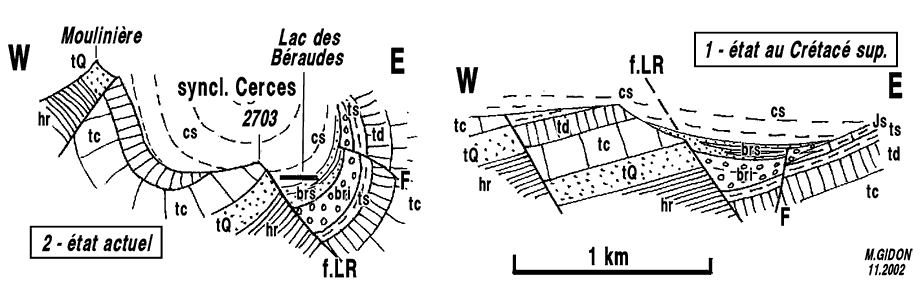 Coupes explicatives de la structure du vallon des Béraudes, au nord du lac. (la topographie n'est pas représentée et l'on a omis les détails accessoires) f.LR = faille du Lac Rouge ; F = faille de la pointe 2753 de la Moutouze (elle est considérée ici comme une faille conjuguée, mineure, de la faille du Lac Rouge). L'origine des brèches massives (bri), sous-jacentes aux marbres en plaquettes, doit être, comme pour celles incluses dans la base des marbres en plaquettes (brs), une érosion de la lèvre ouest (soulevée) de la faille du Lac Rouge. NB. 1 : l'âge ancien de la faille qui tranche en long la crête de la Moulinière est une hypothèse vraisemblable mais non contrôlée. NB. 2 : au sud du lac (crête des Béraudes) la structure est la même, mais l'érosion antérieure au dépôt des marbres en plaquettes est encore plus profonde : elle y a dénudé les quartzites triasiques du compartiment ouest de la faille du Lac Rouge. |
La faille du Lac Rouge est donc très probablement une faille ancienne (sans doute apparue dès le jurassique) et l'on peut penser que les matériaux des brèches des Béraudes ont été arrachés par l'érosion, d'abord au Jurassique supérieur puis au Néocrétacé, de la partie saillante du bloc soulevé formant la lèvre occidentale de cette faille.
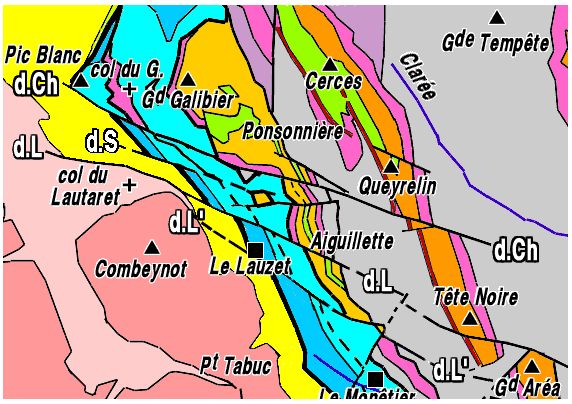
|
Carte géologique simplifiée des chaînons
de la Haute Guisane - Haute Clarée |
|
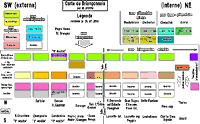 |
Le groupe des unités briançonnaises est décalé vers le bas pour de simples raisons de mise en page. Par contre les dénominations de ces unités comportent parfois plusieurs noms, qui sont disposés de haut en bas pour indiquer les équivalences entre les unités élémentaires affleurant du nord au sud. |
|
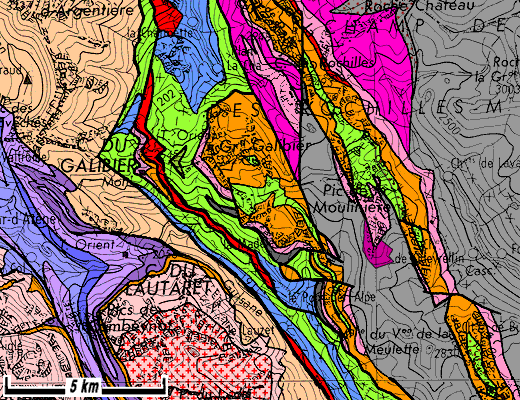
|
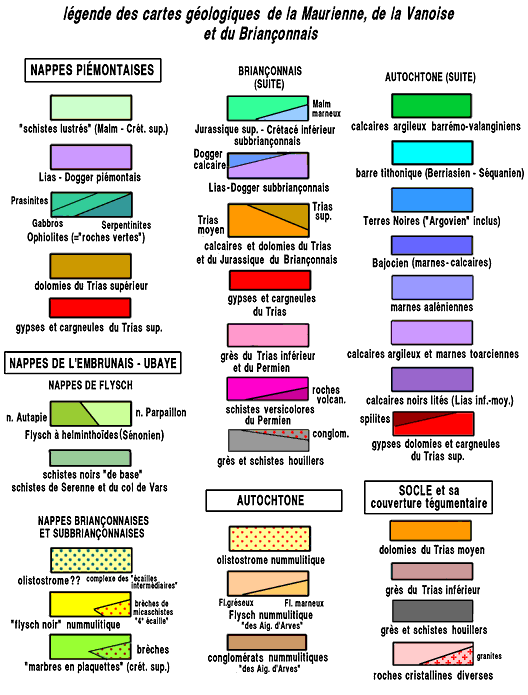
|
Carte géologique simplifiée
des montagnes aux alentours du col du Galibier
redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble
des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",
par M.Gidon (1977), publication n° 074
catalogue des cartes locales de la section Briançonnais
| aperçu
général sur la stratigraphie
du Briançonnais aperçu général sur la tectonique du Briançonnais |
|
|
|
|
| La Ponsonnière |
|
|
|
|
|
|
|
|
"Béraudes" |
|