Seyssins - Fontaine |
Ces deux localités jumelles sont situées en rive gauche de l'entrée amont de la Trouée de l'Isère, là ou le bord occidental de cette dernière se raccorde avec celui du sillon subalpin qui court plus au sud, à partir de Comboire, au pied est du massif du Vercors. Cela se traduit par un changement d'azimut de la coupe naturelle de ce versant, qui devient sensiblement N-S au sud de Fontaine : elle est dès lors conduite à trancher les structures tectoniques majeures (plis et chevauchements) selon un biais très aigu, voire même presque longitudinalement.
A/ Au nord de Fontaine la bordure occidentale de la Trouée de l'Isère sectionne un grand synclinal très ouvert affectant les calcaires du Sénonien supérieur. C'est le prolongement méridional du synclinal de Proveysieux qui comporte, en Chartreuse, un contenu miocène. On y note en outre une subtile modification dans le dessin de ce pli dont le fond est ici incurvé plutôt symétriquement alors qu'il a un fond plat et nettement incliné vers l'est en Chartreuse. Cela est dû au passage, superposé à lui selon cette transversale de la vallée de l'Isère, du "synclinal méso-subalpin" au cœur duquel sont conservés les terrains sédimentaires des massifs subalpins septentrionaux (voir la page "tectonique subalpine") et dont la charnière se manifeste en Chartreuse, avec évidence, dans la montagne du Néron.
Le fond, très plat mais incliné vers l'est, de la partie droite (occidentale) du synclinal
de Villard-de-Lans est limité du côté est par la flexure synclinale de Sassenage (rompue par le chevauchement) et du côté ouest par
la flexure des Engenières (raccord avec son flanc ouest,
flanc oriental de l'anticlinal de Sornin). |
B/ Au sud de Fontaine, à partir de Seyssinet (c'est-à-dire à la latitude de Grenoble), on rentre dans un secteur de caractère géologique assez différent pour y ressentir que l'on y franchit une frontière structurale : elle est constituée par la faille des Perrières de Fontaine, important accident qui limite les reliefs rocheux qui dominent Fontaine et qui détermine leur rebord méridional en s'élevant vers le SW jusqu'à proximité de La Tour Sans Venin.
Sa lèvre septentrionale est soulignée par un rebord rocheux qu'échancrent les entrées méridionales des vallées mortes du Désert de J.J. Rousseau, du Désert de l'Écureuil et de la Combe Vallier. Le long de ce rebord les couches des calcaires à silex du Sénonien supérieur se rebroussent au point de laisser voir les lauzes du Sénonien inférieur à son pied sud-oriental (que longe la branche supérieure du lacet de la D.106b).
Le fait que ces dernières viennent en contact anormal avec les marnes de Narbonne des abords de Seyssinet par l'intermédiaire d'une lame de calcaires du Fontanil épaisse d'une centaine de mètres, souligne clairement l'important rejet de cet accident tectonique.
C/ En amont, donc plus à l'ouest, la faille des Perrières se termine en butant contre une autre faille, qui s'en distingue en se poursuivant, du côté amont avec une orientation presque est-ouest, en passant par le hameau des Bruziers.
Celà se produit précisément 600 m au sud de La Tour Sans Venin, en un point où aboutit également la faille presque N-S de Pariset, qui tranche orthogonalement les couches sénoniennes et les décale dans le sens dextre pour laisser apparaître du côté ouest leur soubassement urgonien (absent du côté oriental en lèvre NW de la faille des Perrières). |
Cette faille des Bruziers délimite du côté sud la butte du même nom, essentiellement formée de Sénonien mais dont le rebord sud laisse voir le soubassement stratigraphique urgonien, toutes ces couches étant affectées d'un pendage nord sub-vertical. En fait cette succession vient simplement compléter vers le bas la série stratigraphique du rebord rebroussé du synclinal des Vouillants - Proveysieux. Par contre elle est orientée selon un azimut proche de E-W, donc très oblique à l'axe de ce pli (qui passe sensiblement au Grand Pariset). De plus elle est bordée du côté nord par un rebroussement, le "synclinal des Bruziers" qui est presque parallèle à la faille du même nom : il doit en représenter un crochon et traduire un déplacement en coulissement dextre de cette faille.
Cette faille majeure se poursuit vers l'ouest jusqu'à rejoindre le pied septentrional des Trois Pucelles, secteur où il apparaît qu'elle doit se connecter d'une manière ou d'une autre au chevauchement du Moucherotte (voir la page "Moucherotte"). Quel qu'en soit le processus elle décale à cette occasion les couches urgoniennes des Bruziers par rapport à celles des Pucelles (verticales dans les deux cas) avec un rejet horizontal dextre de presque 2 km.
Il s'agit du rejet mesuré le long du tracé de la cassure, mais l'attitude verticale des couches décalées ne laisse aucun doute sur son caractère décrochant. Bien que sa lèvre méridionale soit largement masquée, l'accident des Bruziers a un tracé apparemment assez rectiligne en dépit des accidents de terrains qu'il traverse : cela suggère, même si l'on ne connaît pas vraiment le pendage de sa surface de cassure, qu'il s'agit d'une faille très redressée et pas d'un chevauchement. |
A la faveur de cette faille des Bruziers les couches du synclinal de Proveysieux se rebroussent donc, dans ce secteur, en un crochon orienté NE-SW à E-W qui traduit un soulévement de son compartiment méridional. Mais il n'est pas possible de voir dans cette dernière une surface de chevauchement, en raison de son pendage apparemment très redressé et surtout de l'orientation presque E-W des couches de sa lèvre septentrionale, trop oblique au système presque N-S des plis de la région et de ses éventuels chevauchements associés (tel celui de Saint-Ange : voir les pages "Comboire" et "col de l'Arc").
En fait cet accident, qui matérialise la limite entre le domaine méridional, chevauchant, du Moucherotte et celui septentrional, autochtone, de Pariset est plus vraisemblablement l'expression du jeu d'une déchirure sub-verticale, de type transformant, qui a décalé, par un jeu en coulissement dextre les deux tronçons (respectivement de Pariset et du Moucherotte) une unique cassure majeure (considérée depuis plusieurs décennies comme le "chevauchement de la Chartreuse orientale").
|
Commentaires complémentaires relatifs au schéma ci-dessus : |
D/ Prolongement vers le nord de ce dispositif tectonique .
- Le tracé de la faille des Perrières prend naissance, en marge de la plaine alluviale, presque sur la même transversale que celui de l'accident majeur qu'est sur l'autre rive le chevauchement de la Chartreuse orientale (qui y aboutit au pied ouest du Néron). Cela a longtemps conduit à considérer qu'elle en était simplement le prolongement, d'autant qu'elle surélève, elle aussi, les terrains de sa lèvre sud-orientale par rapport à ceux de sa lèvre nord-occidentale. Toutefois un examen plus attentif porte à conclure que cette très probable continuation s'accompagne de divers problèmes qui obligent à en nuancer l'analyse et l'interprétation.
En premier lieu le raccord supposé de leurs tracés se fait au prix d'un décalage de la faille des Perrières d'environ 1 km vers l'est, et surtout d'une différence de son orientation, qui est moins méridienne (N 45 et non N 10). On peut mettre ces changements sur le compte de sa rencontre avec une probable faille transverse de La Buisseratte, ce qui les amènerait à dessiner, à la faveur de leurs rejets antithétiques, un "coin" de poinçonnement horizontal, (voir la page "rapports Vercors - Chartreuse"). D'autre part les caractéristiques de ces deux failles majeures ne sont comparables qu'en ceci qu'elles limitent du côté oriental les affleurements néocrétacés et tertiaires du synclinal de Proveysieux. Par contre leurs lèvres orientales différent beaucoup, notamment par le sens de succession des couches : en effet aux Perrières les marnes de Narbonne s'enfoncent vers l'ouest sous des calcaires du Fontanil alors qu'au pied ouest du Néron ils pendent vers l'est sous l'Hauterivien (donc en sens inverse). La situation au sud de l'Isère ressemble donc plutôt à celle du flanc oriental de synclinal du Néron au nord (ce qui semble cohérent avec un jeu dextre de la faille de la Buisseratte). Quant au rebroussement synforme des couches, qui affecte le bord du compartiment nord-occidental de la faille des Perrières, il ne saurait être le simple prolongement de la charnière orientale du synclinal de Proveysieux, car la direction axiale du premier, proche de N 45, est beaucoup moins méridienne que celle de ce dernier. Mais d'autre part il n'est aucunement prouvé qu'il soit l'expression d'un crochon de chevauchement car on ne voit aucun témoin du repos de la lèvre sud-orientale sur celle nord-occidentale (les terrains de la première n'affleurent qu'en contrebas de ceux de la seconde). Un jeu extensif de cette faille peut donc être envisagé tout aussi plausiblement, comme c'est d'ailleurs le cas pour la faille du pied ouest du Néron. Enfin le cœur de Miocène de ce synclinal, qui est largement conservé en rive droite de l'Isère, n'est respecté par l'érosion au sud que tout en haut des pentes, à Saint-Nizier même. Cela implique une remontée axiale du fond sénonien du synclinal de Proveysieux, ce que l'on peut tenter d'expliquer par le fait qu'il est traversé en biais, dans ce secteur, par le synclinal "médio-subalpin", dont l'axe est de N 45 (voir la page "tectonique du Vercors nord-est"). |
- 2 En ce qui concerne la faille des Bruziers, si elle garde le même azimut, elle devrait se prolonger vers l'est, au delà de son intersection avec la faille des Perrières, en passant par Seyssins village, jusqu'à la vallée du Drac ; mais ceci doit se passer au sein des marnes de Narbonne où son tracé n'est guère repérable. On la perd en tous cas définitivement au delà sous les alluvions de Grésivaudan mais cela laisse à croire que la partie grenobloise de la vallée de l'Isère héberge, au moins jusqu'à Villard Bonnot, un décrochement (sensu lato) similaire à ceux de la bordure orientale de la Chartreuse.
Ce secteur a fait l'objet de la publication suivante : DEBELMAS J. (1965). - Quelques observations nouvelles sur l'extrémité nord-orientale du massif du Vercors. Trav. Lab. Géol. Grenoble t.41, p. 275-281.
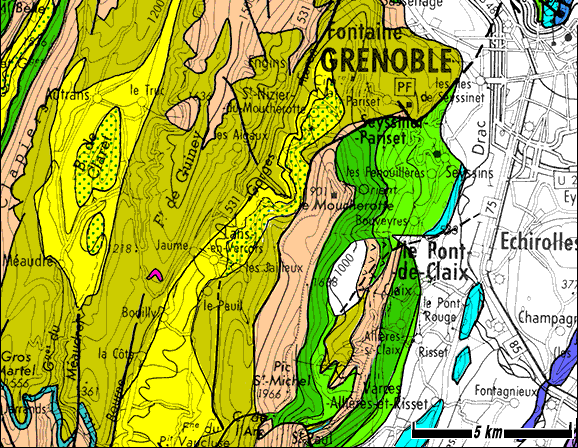
Carte géologique très simplifiée de la partie orientale du Vercors à la latitude de Grenoble.
redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble
des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",
par M.Gidon (1977), publication n° 074
![]() légende
des couleurs
légende
des couleurs
|
|
|
|
| Moucherotte | LOCALITÉS VOISINES | Grenoble sud |
|
|
|
|
|
|
Seyssins |
|